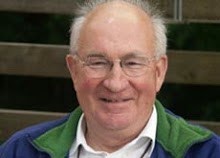mercredi 20 mars 2019
SCANDALES EN EGLISE! ET APRES ?
SCANDALES EN EGLISE! ET APRES ?
Dans la tourmente des scandales qui blessent le visage de l’Eglise catholique, j’aurais plutôt envie de faire silence et pénitence. Mais il faut aussi avoir le courage de débrider la plaie et de passer des constats affligés aux remèdes vigoureux, même s’ils doivent faire mal à l’institution… pour son bien !
On ne guérira pas notre Eglise si l’on n’a pas l’audace de traquer les causes de tels comportements déviants. Le pape François l’a exprimé : le cléricalisme. En effet, certains se sont peu à peu érigés en chrétiens de première classe, avec tous les risques du pouvoir dominateur. Tout cela sous la carapace d’une mission sacrée qui les placerait au dessus des « simples fidèles » et même au dessus des lois de la république démocratique. C’est un détournement vicieux d’une belle vocation aux ministères qui devrait s’accompagner d’un grand respect pour la dignité et la conscience des autres.
Les épreuves que nous traversons doivent changer profondément notre manière de voir et de vivre la mission des prêtres (et des évêques évidemment). Le clergé doit passer par une cure de nouvelle réflexion théologique sur le mystère de sa définition, en évitant les pièges d’une sacralisation sur-dimensionnée qui a autorisé tant d’excès sous les couverts d’une mystique de la fonction.
Il faut oser aller plus loin, et dans deux directions.
Le célibat peut être un bon serviteur de la mission des prêtres pleinement au service des communautés. Mais l’obligation universelle du célibat pour les prêtres de l’Eglise latine est certainement une erreur qui peut engendrer des dommages collatéraux graves. Conformément à la plus ancienne tradition, celle qui remonte au temps des apôtres et n’a cessé de régner dans les Eglises d’Orient (y compris catholiques), le célibat peut être recommandé, mais jamais prescrit. Non seulement on se prive de prêtres possibles en faisant du célibat une condition d’admission imposée à tous. Non seulement on a renoncé au service d’excellents prêtres qui ont choisi, par cohérence, de se marier plutôt que de biaiser avec leur promesse. Sans le vouloir, on a suscité chez quelques uns des frustrations dangereuses ou obscures qui peuvent déboucher sur des comportements particulièrement toxiques pour les personnes les plus fragiles. Pour être un précieux auxiliaire du ministère, le célibat doit être choisi en toute liberté et vécu au cœur de communautés plus fraternelles que hiérarchiques.
Enfin, il faut revoir la place que notre Eglise accorde aux femmes dans ses structures et dans ses missions. Tandis que dans nos sociétés l’égalité hommes-femmes est revendiquée et souvent promue, nous sommes encore prisonniers de traditions qui empêchent les femmes de participer pleinement à certains ministères. On apprécie les services des femmes dans les communautés où elles constituent souvent la grande majorité des chrétiens présents et actifs. Mais quand il s’agit de décisions et d’offices importants, elles ne sont pas là parce qu’on les a exclues. Pourquoi ? Uniquement parce qu’elles sont femmes, autrement dit des hommes (êtres humains) pas comme les autres (les mâles).
Dans une interprétation éclairée des textes saisis dans leur contexte, rien ne permet, au niveau des fondements bibliques, de justifier une telle discrimination, même pour les ministères ordonnés. Au contraire, l’attitude prophétique de Jésus à l’égard des femmes et certains principes tenus par les apôtres, tout nous invite à reconsidérer le rôle des femmes dans notre Eglise.
Je suis persuadé que dans ces deux évolutions se trouve une partie des remèdes que nous cherchons pour juguler les dérives que nous pleurons. Il est temps de passer des belles déclamations aux actes concrets. Nous avons tous à y gagner, et surtout le rayonnement de l’Evangile du Christ que les Eglises se doivent d’annoncer à temps et à contretemps, et d’abord avec la transparence de la vérité et l’humilité de l’amour.
Claude Ducarroz, ancien prévôt de la cathédrale de Fribourg
Cet article a paru dans le quotidien LE TEMPS du 21 mars 2019 p. 11
samedi 2 mars 2019
Juste avant le Carême
Homélie
8ème dimanche du temps ordinaire
« L’Eglise peut me faire aimer beaucoup de choses. Mais elle ne me fera jamais aimer la morale, surtout celle qu’elle prêche aux autres sans la pratiquer elle-même. »
Par les temps qui courent, notamment dans notre Eglise -pas besoin de faire un dessin-, vous pouvez comprendre que j’ai repensé à cette réflexion d’un ami en méditant l’évangile de ce dimanche. « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? »
Tantôt en se faisant oculiste, tantôt en devenant horticulteur, Jésus nous met en garde contre la tentation des bien-pensants à faire la morale tous azimuts tandis qu’ils se dispensent de l’observer eux-mêmes. Et le jugement est sans appel : « Hypocrites ».
On a entendu de telles invectives au cours des débats qui secouent notre Eglise actuellement à propos de la pédophilie et d’autres abus dont se sont rendus coupables certains membres du clergé.
Le pape François a eu le courage de reconnaitre et de dénoncer ces crimes d’autant plus horribles qu’ils ont été commis dans le cadre d’une Eglise qui prône les valeurs de l’Evangile et par conséquent devrait offrir à tous – et d’abord aux plus petits- un environnement pastoral particulièrement digne de toute confiance.
Sans généraliser –ce qui serait une profonde injustice- quelque part quelque chose est pourrie dans l’arbre de notre clergé, à cause d’un certain cléricalisme, et parfois jusque dans les plus hautes branches.
Mais le pape a aussi eu raison de mettre en évidence, dans notre société matérialiste et hédoniste, tant d’autres atteintes à la dignité des enfants qui subissent, en innocents particulièrement fragiles, les attaques de la violence domestique ou militaire, de la misère par la faim et l’abandon, de l’exploitation par la pornographie impunément diffusée.
Je devine ce que vous allez me répliquer : Voilà, il recommence avec sa petite morale culpabilisante.
Alors, si vous le voulez bien, sortons-en, mais pour passer chez l’oculiste et l’horticulteur Jésus de Nazareth, notre sauveur.
Sans accuser personne, mais en reconnaissant que nous sommes tous un peu malades de quelque péché, avoué ou secret, n’avons-nous pas tous besoin d’une cure de sainteté et d’abord d’un chek-up spirituel, qui pourraient coïncider avec le carême qui approche ?
Oui, vérifier la santé de notre œil intérieur, celui qui juge impitoyablement, celui qui met toujours la faute sur les autres, celui qui réclame la miséricorde pour soi sans accorder aucune indulgence aux autres. N’y aurait-il pas quelque paille à enlever, qui nous permette ensuite de voir notre prochain autrement, parce que nous l’aurons regardé un peu plus avec le regard de Jésus ?
Passons au verger de notre personne et de notre personnalité. Et là, nous dit Monsieur Jardinier Jésus, il faut aller jusqu’au cœur des arbres, au niveau des racines et de la sève, pour vérifier leur bonté et augmenter le trésor qu’ils abritent. Sonder un peu mieux, par la prière et la méditation de la parole de Dieu, la qualité de notre figuier et de notre vigne. N’y aurait-il pas des épines à ôter, des ronces à éliminer ?
Et vous allez me redire : Encore de la morale, toujours de la morale !
Ce ne serait, en effet, que de la morale – pas très aimable- s’il n’y avait pas pour notre vie humaine un dessein supérieur, une feuille de route toute pascale, celle que l’apôtre Paul a rappelée dans sa première lettre aux Corinthiens. Depuis notre baptême, nous carburons avec l’ADN du mystère pascal, nous sommes des promis à la résurrection, parce qu’un jour notre être mortel revêtira l’immortalité.
Cette pâque commence en nous dès ici-bas, y compris à partir de nos morts et de nos tombeaux, grâce aux pardons reçus et donnés, grâce à la vraie liberté que nous apportent de multiples conversions sous les énergies de l’Esprit Saint, grâce aussi aux partages avec d’autres, et notamment en Eglise, quand nous nous entraidons à marcher plus droit sur la route de l’Evangile. Et les sacrements sont là pour nous fortifier.
Certes, nous avançons tous en boitant, mais nous nous donnons la main. Nous cherchons notre voie, mais il y a en chacun de nous assez de lumière intérieure pour persévérer dans la recherche du meilleur. Notre vie est peut-être dure, pour toutes sortes de raisons, et parfois même à cause de nos propres fautes, mais il nous arrive, n’est-ce pas ?, d’éprouver une certaine joie que personne ne peut nous enlever. C’est celle de suivre Jésus pas à pas, ou de le retrouver au détour d’une épreuve, en attendant l’éternel rendez-vous de la vie éternelle.
Car la mort –sous toutes ses formes- a été engloutie dans la victoire, celle de la croix, celle de la pâque. C’est pourquoi il ne faut jamais désespérer, ni de l’Eglise malgré les péchés de ses membres, ni de nous-mêmes malgré les nôtres, parce que, depuis un certain matin de printemps en Palestine, rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus vivant.
Alors, en toute confiance et humilité aussi, comme nous le rappelle l’apôtre Paul, « prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue. »
Bon Carême.
Claude Ducarroz
mercredi 20 février 2019
Ah!, ces belles vocations...
Ah ! ces belles vocations…
« J’ai l’impression qu’il/elle a la vocation ».
Quand j’entendais de tels commentaires, au temps de ma jeunesse, ça signifiait que la personne montrait des signes qui la prédestinaient à la vie presbytérale ou religieuse.
Heureusement, on a pris conscience –surtout depuis le concile Vatican II- que tout baptisé est un « appelé » à vivre de la vie du Christ comme témoin de l’Evangile, quelle que soit ensuite sa vocation plus précise, dans l’animation de la communauté chrétienne ou dans les innombrables insertions possibles au cœur de la société.
Certaines vocations sont d’ailleurs particulièrement mises en évidence puisqu’elles sont consacrées par un sacrement, comme par exemple le mariage et plusieurs ministères. Il suffit de relire le Nouveau Testament : que de richesses dans la variété des charismes, services et fonctions suscités par la liberté de l’Esprit qui souffle où il veut.
Mais l’honnêteté oblige à ajouter quelque chose : notre Eglise, à tort ou à raison, a aussi institué des interdictions de vocations.
Le mariage : une si belle vocation, que l’apôtre Paul –pourtant célibataire- présentait comme « un grand mystère » signifiant la relation d’amour entre le Christ et l’Eglise. Dans notre Eglise de rite latin, les prêtres sont interdits de mariage, puisque tous doivent être célibataires.
Les ministères ordonnés : que de belles vocations quand elles sont vécues comme des engagements à plein cœur et à plein temps « à cause de Jésus et de l’Evangile ». Mais les femmes sont interdites de ministères consacrés.
On peut trouver de bonnes raisons à ces interdiction qui, de fait, empêchent certains chrétiens d’accéder à tel ou tel bien du Royaume, ces biens étant évidemment des grâces absolument gratuites, pour les hommes comme pour les femmes d’ailleurs.
De bonnes raisons ? Récemment les autorités supérieures de notre Eglise ont rappelé ces décisions en même temps que les raisons qui les justifient à leurs yeux. Dont acte.
Mais qu’en pense l’Eglise ? Celle dont on sait mieux maintenant qu’elle déborde largement les sphères des hiérarchies constituées, celle à laquelle faisait allusion l’auteur de l’Apocalypse en écrivant : « Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Eglises ». Ap 3,22. Celle aussi que le pape François a mobilisée dans la triste affaire de la pédophilie parmi les clercs lorsqu’il a écrit au peuple de Dieu : « Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin… Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu. »
Mais précisément, ce peuple de Dieu, dans la symphonie multicolore de toutes ses vocations issues du baptême, est-ce qu’on l’écoute, est-ce qu’on l’entend ? Est-ce qu’on ose lui poser certaines questions en prenant ensuite au sérieux ses réponses ? Ce qui va bien plus loin qu’une assemblée mondiale d’évêques, si opportune soit-elle. Je pense en particulier à ce que vivent, pensent et font les femmes, trop longtemps servantes muettes dans notre Eglise, alors qu’elles montrent tant de dévouement au Christ et à son Evangile, dans et pour l’Eglise.
Tiens ! Et si on se posait d’abord la question : le Seigneur de l’Eglise, que pense-t-il de tout cela ?
Evangile en main, encore un beau mystère qui reste à explorer et à implorer.
Claude Ducarroz
A paru sur le site cath.ch
dimanche 3 février 2019
Homélie 27 janvier
Homélie
Unité 2019
Il y avait longtemps qu’on ne s’était plus revu. Mais jadis on avait partagé la joie d’animer des camps bibliques pour et avec des jeunes. André était un pasteur protestant. A la faveur de notre revoir, il me dit soudain, en me fixant dans les yeux, et les siens pleins de larmes : « Vous les catholiques, vous nous manquez. Mais je n’ai pas l’impression que nous, les protestants, nous vous manquions, à vous les catholiques. Vous vous estimez tellement riches de tout que vous pensez n’avoir pas besoin de nous. »
J’ai compris ce jour-là une chose importante : l’œcuménisme ça commence quand l’autre nous manque, tel qu’il est, différent certes, pas seulement complémentaire, mais indispensable à la vérité et à la beauté de la famille chrétienne, l’Eglise de Jésus-Christ.
Sincèrement, est-ce que les autres chrétiens vous manquent ? Ou est-ce que, comme catholiques, vous ne manquez de rien, vous ne manquez de personne, pour faire Eglise aujourd’hui ?
« Le corps ne fait qu’un, dit l’apôtre Paul, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit que nous tous, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Or vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. »
Alors où est le problème, me direz-vous ? C’est que, malgré le même baptême, malgré l’unique Esprit, l’histoire et nos histoires - et surtout nos péchés personnels et communautaires-, nous ont éloignés les uns des autres jusqu’à nous séparer, parfois sur des points importants de notre fidélité à l’Evangile du Christ. Il y eut même, y compris chez nous en Suisse, des guerres de religion qui ont transformé en ennemis des chrétiens qui n’auraient jamais dû cesser d’être des frères et sœurs, malgré de légitimes diversités.
Héritiers involontaires de cette histoire et de ces histoires, il nous faut maintenant remonter la pente de nos divisions. Heureusement, nous pouvons rendre grâces pour les importants et nombreux progrès déjà accomplis. Ils ont transformé nos relations, jadis faites au mieux d’indifférence, souvent de méfiance et parfois même d’hostilité, en connexions de respect, de collaboration et même de communion sur des points essentiels.
Mais il demeure encore des sujets qui fâchent, des nœuds à défaire, des consensus à créer pour que nous puissions correspondre à cette prière que le Christ adressait à son Père la veille de sa mort, en pensant aussi à nous aujourd’hui : « Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous afin que le monde croie que tu m’as envoyé. » Autrement dit la réussite du projet œcuménique, ce sont des chrétiens unis dans l’essentiel et rayonnant de justes diversités. Ce projet d’une Eglise unie comme un seul corps dans la belle variété de ses membres, conditionne plus que jamais l’annonce et le témoignage pour l’Evangile dans notre monde.
Il ne faut pas le nier : il y a encore quelques obstacles sur cette route. Par exemple comment comprendre et célébrer l’eucharistie comme signe d’une vraie communion, comment apprécier les services de nos autorités, ces apôtres, prophètes et enseignants dont parle l’apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens ; comment réaliser la communion avec nos frères et sœurs aînés, par exemple nos défunts, les saints et surtout Marie, la mère de Jésus, celle qu’il nous a lui-même donnée pour mère.
Heureusement, nous avons déjà en commun la Parole de Dieu, la Bible, avec ses trésors de vérités à connaître et à vivre. Vous l’avez entendu, Jésus a pu dire chez lui à Nazareth : « Aujourd’hui s’accomplit cette Ecriture que vous venez d’entendre. » Connaître et mettre en pratique l’Evangile : tout nous invite à le faire tous ensemble dès maintenant. Et rien ne nous empêche d’appliquer ensemble le programme d’engagements présenté par Jésus lui-même à la synagogue de son village : « Porter la bonne nouvelle aux pauvres, ouvrir les yeux des aveugles, remettre en liberté les opprimés, etc… » Avec la grâce de Dieu évidemment.
Le pape saint Jean-Paul II a défini l’œcuménisme comme un « échange de cadeaux ». Autrement dit chacun a quelque chose à offrir et quelque chose à recevoir…offrir à l’autre…recevoir de l’autre. A une condition : que celui qui estime être assez doté pour avoir à offrir le fasse avec respect et humilité, sans arrogance ni orgueil. Et que celui qui estime avoir à recevoir, qu’il l’accepte avec la même humilité, mais sans se sentir humilié, plutôt avec reconnaissance.
A coup de cadeaux échangés et partagés, sans jamais brandir la comptabilité des meilleurs et des moins bons, nous parviendrons un jour, sous la guidée de l’Esprit, à nous retrouver tellement proches, tellement frères et sœurs, que le partage eucharistique à la Table enfin commune deviendra une bienheureuse évidence, la causse d’une nouvelle joie.
Prions à cette intention. Agissons à cette intention.
Car vous êtes bien tous, mais chacun pour sa part, le corps du Christ.
Claude Ducarroz
Homélie
Homélie
3 février 2019
Nazareth ! Jésus de Nazareth ! C’est ainsi qu’on l’appelait dans sa région d’origine, la Galilée. On le nommait aussi fils de Joseph, ou fils de Marie, ou tout simplement le fils du charpentier.
Et c’est précisément dans la synagogue de son village que nous retrouvons Jésus aujourd’hui, oui à Nazareth dont on disait alors : « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? » Eh ! bien Jésus, le fils de l’homme et le fils de Dieu, est sorti de là. Mais il faut aussitôt ajouter : à condition d’en sortir, précisément.
En effet, pour réaliser sa mission, Jésus a dû opérer une double sortie, des prises de distance nécessaire à l’accomplissement de la volonté de Dieu son Père sur lui.
Jusqu’à 30 ans environ, comme l’attestent les Ecritures, Jésus fut un enfant puis un jeune homme qui « grandissait en taille, en sagesse et en grâces, devant Dieu et devant les hommes ». Homme parmi les hommes. Luc 2,40 et 52.
Plus encore, il était soumis à ses parents, et sa mère Marie « conservait et méditait tous ces événements dans son cœur ».
Encore que, à l’âge de 12 ans, en profitant du pèlerinage annuel à Jérusalem, quand il faussa compagnie à ses parents tout angoissés qui lui reprochèrent cette petite fugue, il eut cette parole d’avertissement : « Ne savez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »
Plus tard, à deux reprises, il eut à nouveau l’occasion de remettre chacun à sa vraie place, selon son projet de vie à lui.
Quand sa mère et sa parenté se tenaient dehors alors que la foule les empêchait de le contacter, Jésus dit en promenant son regard sur ses disciples: « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. »
Il y avait aussi tout un clan à Nazareth. En admirant le jeune Jésus tellement savant dans la synagogue, « ils s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche ». Mais quand Jésus leur signifia que sa mission doit dépasser largement les confins de son village et même les limites de son peuple, ils deviennent furieux. Que le Nazaréen Jésus se mette à vanter la foi de certains païens, c’en est trop. Ils le chassent violemment hors de son village.
On signale même, une autre fois, que des gens de sa parenté sont venus pour s’emparer de lui en estimant « qu’il avait perdu la tête ». On comprend alors la conclusion de Jésus lui-même, devenue un proverbe toujours d’actualité : « Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. »
Qu’est-ce que tout cela peut avoir encore à dire à nous, qui sommes l’Eglise d’aujourd’hui, autrement dit la famille de Jésus en notre temps ?
Une statistique est sortie cette semaine, qui doit nous faire réfléchir, même si j’ai conscience que les chiffres ne disent pas tout, et même pas l’essentiel.
En 1980, en Suisse, le 90% de la population se rattachait au christianisme, à travers les deux confessions principales, la catholique et la protestante. Aujourd’hui, en 2017, nous ne sommes plus que 60%. Attention ! pas tellement parce que d’autres religions ont progressé parmi nous – les musulmans forment moins de 5% de notre population-, mais parce que les personnes qui se déclarent sans religion représentent maintenant 26 % de notre population, à savoir légèrement plus que le nombre des protestants. Quant aux catholiques, nous sommes encore 36%, mais aussi en baisse.
Nous pourrions aussi nous replier sur nous-mêmes, par un réflexe de ghetto assiégé, en ignorant ceux qui ne pensent pas comme nous ou en maudissant ceux qui nous ont quittés. Ce serait une manière un peu lâche de refuser de nous remettre en question nous-mêmes, sur les raisons de certains éloignements ou de certains abandons.
Je rencontre de plus en plus des gens qui, fondamentalement, disent oui à Jésus, mais non à l’Eglise, du moins telle qu’elle se présente, même aujourd’hui, avec le pape François. Je ne dis pas qu’ils ont toujours raison, mais je crois que nous devons nous interroger, y compris les prêtres évidemment.
Et revenir à l’essentiel, à savoir la figure toujours actuelle et toujours vivante de Jésus de Nazareth, notre frère et notre Dieu. Et son Evangile évidemment. C’est plus que jamais urgent.
Alors, c’est lui qui nous envoie vers les autres, pas pour les juger et encore moins pour les condamner, mais comme le répète sans cesse saint Paul à la suite du Christ, pour les aimer, gratuitement, à commencer par les plus pauvres et les plus souffrants, ces frères et sœurs humains des périphéries de toutes sortes dont parle si souvent notre pape François.
Comme le prophète Elie fut envoyé vers la veuve de Sarepta au pays de Sidon, comme Elisée fit tout pour guérir Naaman le Syrien.
Nous n’allons pas nécessairement améliorer nos statistiques. Jésus ne nous demande pas de faire du chiffre, mais de faire des signes, des signes d’évangile, de témoigner pour sa vérité en l’enrobant d’amour, de justice et de paix.
Et Jésus, dit l’évangile, « passant au milieu d’eux, allait son chemin. »
C’est aussi lui qui dit un jour à ses disciples inquiets pour leur avenir, et donc aussi à nous : « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. »
Claude Ducarroz
lundi 21 janvier 2019
Vive les gilets verts!
Vive les gilets verts !
On les croyait essentiellement addicts au smartphone et à la tablette, vautrés devant la télé ou gavés de musique et de danse dans leur vent. C’était faux. Les jeunes - pas tous évidemment - se sont mobilisés pour sauver notre planète. Par milliers, ils ont défilé pour exiger bruyamment que notre environnement bénéficie de soins plus intensifs, avant qu’il ne soit aux soins palliatifs. Devant l’indifférence de beaucoup d’adultes, devant l’incurie de nombreux politiques, ces jeunes se sont réveillés et, grâce aux réseaux sociaux, ils ont lancé un mouvement transfrontalier d’engagements pour l’écologie. On ne peut que féliciter et remercier ces nouveaux « gilets verts », d’autant plus que, contrairement à certains autres, ils ont opté pour des actions fortes mais non violentes, au lieu de céder aux facilités de l’émeute et de la casse.
Mais approuver ces nouveaux écolos jeunes ne suffit pas. Ni pour nous ni pour eux.
Les adultes, et singulièrement nos leaders de toutes sortes, doivent entendre ces cris qui devraient nous interpeler tous. L’avenir de notre planète est l’avenir de notre humanité puisque nous n’avons qu’une seule maison commune ici-bas. Celles et ceux qui l’habiteront plus longtemps que nous doivent pouvoir y vivre et s’épanouir dans des conditions favorables, même si elles seront jamais parfaites. Que les jeunes –notre plus sûr avenir- nous le rappellent avec démonstrations à l’appui ne peut que nous faire réfléchir et agir.
Mais les jeunes le savent aussi. Il ne suffit pas de brandir des pancartes et de pousser des cris pour améliorer la planète terre. Eux aussi doivent revoir leur mode de consommation, leur capacité à résister aux séductions publicitaires, les choix à opérer dans les achats et l’usage des choses.
Jeunes et adultes, nous avons tous à nous convertir à certaines valeurs qui respectent vraiment notre environnement et promeuvent la dignité de toute personne humaine partout dans le monde, comme le pape François l’a proposé dans son encyclique prophétique Laudato si. C’est un merveilleux combat qui doit être à la fois pacifique et efficace. Que les jeunes s’y engagent maintenant avec leurs slogans, leurs musiques et leurs rêves, c’est un signe d’espérance qu’il nous faut soutenir, à condition que chacun, quel que soit son âge, allie les paroles aux actes concrets. Il y va de la cohérence écologique, bien plus importante que la couleur des gilets.
Claude Ducarroz
A paru sur le site cath.ch
mardi 15 janvier 2019
Oecuménisme 2019
Entre euphorie et déprime
A moins qu’elle soit devenue une tradition plus soporifique que stimulante – ce qu’à Dieu ne plaise !- la semaine de prière pour l’unité des chrétiens nous rappelle opportunément notre devoir sacré de prier et d’agir pour la réconciliation plénière des Eglises chrétiennes.
En fait, le chemin de l’œcuménisme réaliste se faufile toujours plus difficilement entre l’euphorie des uns et la déprime des autres, deux attitudes inverses qui aboutissent au même résultat : il n’y a plus rien à faire… et passons à autre chose !
Les euphoriques estiment que tout va bien –ou presque- dans la biosphère œcuménique puisque les Eglises, du moins chez nous, ont enfin compris qu’il fallait s’accepter différentes pour le bien de tous. Heureusement, il est dépassé le temps où les chrétiens se situaient réciproquement en concurrents, en adversaires et même en ennemis. Bénissons le Seigneur : la fraternité a pris le relais. On s’entend bien entre communautés, on collabore souvent, on abandonne les points de friction encore chauds à la réflexion des spécialistes théologiens. Et surtout restons-en là, sans se compliquer la vie par des recherches de meilleure unité qui risquent de créer de nouvelles divisions au lieu de nous conforter dans la jouissance paisible de notre communion bien suffisante.
Mais il y a aussi des déprimés de l’œcuménisme. Avaient-ils placé la barre de l’unité trop haute ? Ils avaient imaginé, notamment à la faveur de l’élan provoqué par l’entrée de l’Eglise catholique en œcuménisme lors du concile Vatican II, que tous les obstacles fondraient rapidement comme neige au soleil de la grâce divine. Et ils constatent, navrés, que des points de rupture subsistent, que des nœuds peinent à se dénouer, que la dynamique œcuménique se perd dans le sable des vielles traditions de crispation sur certains points. Il y a toujours des noyaux durs qui nous séparent, y compris dans la vie courante de nos communautés. Il suffit de penser à l’eucharistie qu’on souhaite pouvoir partager librement, aux questions liées aux ministères –par exemple celui des évêques et du pape-, aux relations avec les saints, et notamment avec la Vierge Marie. Sans compter des problèmes autour de l’éthique, qui nous divisent encore souvent quand il s’agirait de pouvoir prendre des positions communes dans notre société.
Je comprends toutes ces réactions. Mais au lieu de me décourager, elles me stimulent. A reméditer sans cesse le projet de Jésus pour ses disciples, à revisiter les témoignages des premières communautés chrétiennes sous la guidée des apôtres, je rends grâce pour le chemin parcouru grâce à la magnifique « utopie œcuménique » promue par des pionniers qui furent de grands prophètes de l’Evangile. Nous revenons de si loin, et nous nous sommes tellement rapprochés. Mais je dois bien admettre qu’il y a encore du chemin à parcourir pour parvenir –avec la grâce de Dieu- à concilier encore mieux les exigences de l’unité profonde entre tous les chrétiens et une juste diversité entre les Eglises, de manière à former une véritable « Eglise d’Eglises », enfin conforme au dessein et à la prière du Christ pour les siens.
Que la maison commune de tous les chrétiens soit encore en chantier, ça m’invite à venir y travailler avec grande espérance. Il y a assez de belles constructions réussies pour ne jamais se décourager. Il y a encore assez à œuvrer pour s’investir avec ardeur.
Etre un artisan –même très modeste- sur ce chantier-là, c’est un beau service. C’est surtout une belle joie, toute imprégnée de l’Esprit Saint.
A paru sur le site cath.ch Claude Ducarroz
Inscription à :
Articles (Atom)