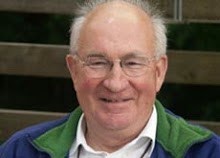Homélie
Epiphanie
2014
La périphérie !
les périphéries !
Depuis que le pape François s’est mis à
employer souvent cette expression, elle s’est acclimatée dans la vie de
l’Eglise, comme un oiseau original en train de faire son nid dans l’arbre de la
pastorale.
Il y a les périphéries géographiques, les gens
qui vivent au loin. Il y a aussi les périphéries intérieures, celles et ceux
qui se sont éloignés ou qui vivent très loin des expériences humaines proposées
par le Christ et son évangile. Et ceux-là peuvent être très proches. Ils
peuvent même être…nous, à tel moment de notre existence, dans tel repli secret
de notre personnalité.
La fête de ce jour -la venue de ces mages
énigmatiques auprès de l’enfant Jésus- résonne en plein dans le mille d’une
pastorale des périphéries. Ils viennent du lointain Orient, mais ils sont
surtout désorientés par la disparition de l’étoile qui les guidait. Ils ne sont
pas des juifs, mais des païens, ce qui prouve combien ils sont encore loin de
connaître vraiment les promesses messianiques révélées au peuple d’Israël. Ce
jour-là, à Jérusalem puis à Bethléem, c’est la périphérie qui vient au centre,
ce sont des païens qui cherchent assidument du côté du roi d’Israël, ce sont
des mages exotiques qui aboutissent à Jésus et finissent par se prosterner
devant lui pour l’adorer avec joie en lui offrant quelques cadeaux de grand
prix.
Belle leçon pour l’Eglise ! Je crois que
depuis l’arrivée du pape François, des hommes et des femmes venus de loin dans
leur géographie intérieure se sont remis en route en se tournant d’abord avec
une certaine curiosité vers une Eglise plutôt étonnante, puis en s’intéressant
de plus près au message dont elle est porteuse, avec l’éventualité d’aller
peut-être jusqu’à ce Jésus qui est lui seul le sauveur du monde. Il y a des
signes qui vont dans ce sens. Ils doivent aussi nous interpeler, nous.
Sommes-nous prêts à accueillir, comme sans
doute Marie l’a fait pour ces mages insolites, les personnes qui viennent de
loin, qui sont très différentes de nous, qui cherchent à tâtons dans leur vie,
qui parcourent une existence en zigzag ? Nous risquons toujours, nous les
chrétiens dits pratiquants, de nous retrouver un peu trop confortablement entre
nous, les mêmes avec les mêmes. Oui, de nous complaire dans un cercle certes pieux et même chaleureux, mais qui
s’est peut-être refermé, au lieu de garder toujours la porte ouverte sur des
nouveaux, autres, parfois dérangeants, venus des Orients de l’humanité en quête
de sens et de salut.
Les chefs des prêtres et les scribes d’Israël
avaient les bonnes réponses théoriques et même théologiques, mais ils n’ont pas
accompagné les mages jusqu’à la crèche. Et le roi Hérode s’est muré dans sa
peur de perdre son pouvoir et ses attributs au point de devenir cruel. Ce sont
des tentations de toujours, et par conséquent encore d’aujourd’hui, quand
débarquent des nouveaux venus déconcertants, même dans des communautés à
caractère religieux.
Avec les mages, la périphérie est venue au
centre, vers Jésus. A la fin de l’évangile –le même, celui de Matthieu-, c’est encore une autre
démarche qui est proposée par le Christ ressuscité. Il s’agit pour la communauté chrétienne de ne
plus seulement attendre que les lointains viennent à elle comme des mages sages,
mais il lui est demandé d’aller vers les lointains, là où ils sont, ces mages, c'est-à-dire,
ailleurs, loin et parfois très loin. « Allez donc », dit Jésus aux
apôtres, « de toutes les nations, faites des disciples… et moi je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » On sait comment,
après de don de l’Esprit à Pentecôte, ces mêmes apôtres sont partis dans toutes
les directions, ce qui explique d’ailleurs pourquoi nous sommes devenus
chrétiens, nous aussi en Occident.
L’Epiphanie appelle la Pentecôte missionnaire.
Il nous faut rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui, au cours de la
longue histoire de l’Eglise, ont quitté leurs familles et leurs pays pour s’en aller au loin rejoindre des frères
et sœurs en humanité. Ils l’ont fait à leurs risques et périls, afin de les
aider à vivre plus humainement et à découvrir la joie de rencontrer le Christ,
le sauveur du monde.
Mais nous savons maintenant que les périphéries
intérieures à évangéliser sont aussi parmi nous ici, et même parfois en nous.
Les Eglises des pays dits de « vieille chrétienté » sont-elles assez
perspicaces pour repérer les périphéries présentes dans notre société ?
Sont-elles assez audacieuses pour se porter au devant des mages actuels, avec
leurs valeurs certes, mais aussi avec leurs erreurs, afin de leur proposer,
humblement mais clairement, le supplément d’humanité qu’offre gratuitement
l’évangile de Jésus ?
Il y a des terrains nouveaux à ne pas manquer
sous peine de tourner en rond avec un évangile ressassé au lieu d’être annoncé.
Pensons au monde des moyens de communication modernes, aux milieux de la
science de pointe, aux arènes de la politique, de l’économie et de l’écologie,
jusqu’aux eaux parfois troubles des nouvelles cultures et des loisirs.
Accueillir chez nous, c’est bien. Aller vers, c’est
tout aussi nécessaire. « Toutes les nations », disait Jésus, et
« jusqu’au bout du monde ». Et tout cela est maintenant un peu
partout, y compris chez nous. Y compris en nous.
Pour de nouvelles Epiphanies, pour de nouvelles
Pentecôtes. Jusqu’à ce que tous finalement, comme les mages, en voyant l’étoile
du Christ, en éprouvent une très grande joie.
Et une plus grande encore en se prosternant
devant lui.
Claude
Ducarroz