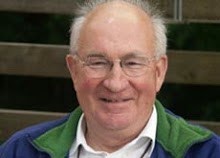Homélie
du 23ème dimanche ordinaire
Et si nous prenions l’évangile à
l’envers ?
Pas pour dire le contraire évidemment, mais
pour faire le chemin à rebours de ce qui nous est proposé aujourd’hui.
Au chapitre 18 de son évangile, saint Matthieu
nous parle des relations fraternelles dans les communautés chrétiennes. On y
remarque d’emblée que rien n’est simple. Si ça peut nous consoler ou plutôt
nous encourager, il y avait aussi des tensions, et la bonne résolution des
tiraillements n’était pas facile à trouver. Mais ici il part du conflit, passe
ensuite par la prière et finit par déboucher sur le mystère de la présence du
Christ au milieu des siens rassemblés en son nom.
Je vous propose donc de faire le voyage en sens
inverse.
Comme chrétiens –ainsi que ce nom l’indique-,
nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, surtout dans une communauté aussi
typée qu’une paroisse, et évidemment à un degré suprême quand nous participons
ensemble à l’eucharistie.
Il me semble que tout doit –ou devrait- commencer par là : prendre ou reprendre
conscience de cette présence mystérieuse de Jésus en nous et au milieu de nous,
comme il nous l’a promis. S’il est au milieu de nous, c’est parce qu’il est en
nous, en moi, mais aussi dans les autres.
Est-ce que ça ne change pas dès lors mon regard
sur ces autres avec lesquels j’ai peut-être quelques problèmes de
relation ?
Est-ce que ça ne peut pas finalement
transfigurer la relation elle-même, de savoir que nous sommes tous habités par
le même Seigneur, animés par le même Esprit comme enfants du même Père ?
Il nous faut acquérir ce réflexe avant toute
autre chose : nous sommes aimés ensemble à égalité par l’Amour même, celui
qui vient faire sa demeure en nous, celui qui vient nicher au milieu de nous.
Mais un tel acte de foi très mystique ne va pas
résoudre d’un seul coup, comme par enchantement, tous les problèmes. C’est
vrai. Et c’est là qu’intervient la deuxième étape, à savoir la prière qui
consiste à se mettre d’accord pour demander ce qu’il nous faut à notre Père qui
est aux cieux.
Je suis persuadé que des personnes qui prient
les unes pour les autres, et à fortiori les unes avec les autres, sont sur le
bon chemin de l’amour et, s’il le faut, de la réconciliation. Car prier fait
œuvre de conversion, d’apaisement, de sagesse, de meilleure clairvoyance. Les
taupinières cessent d’être des montagnes et des cœurs exposés à l’irradiation
de la grâce sollicitée dans la prière ont rentré leurs griffes et ouvert les
sources de la bienveillance et peut-être du pardon.
Quand ça demeure difficile d’aimer, quand il
semble encore impossible de pardonner, nous pouvons encore prier, pour nous et
pour les autres. Peu à peu, sous le rayonnement de cette prière sincère, ce qui
est lié va se délier, des nœuds se défaire et des solutions apparaître à
l’horizon.
Enfin il
y a le dialogue. C’est ce que Jésus met en scène selon l’évangéliste Matthieu. Car
le dialogue n’est pas une invention moderne à l’ère de la communication tous
azimuts. Jésus recommande même une formule à trois degrés, qui prouve le bon
sens du Sauveur.
* La rencontre seul à seul au lieu de monter
aussitôt sur ses grands chevaux sans avoir essayé l’humble face à face dans la
discrétion et l’humilité.
* Mais il y a aussi le dialogue facilité et
soutenu par de tierces personnes qui peuvent rendre le service de la médiation.
On doit pouvoir exercer ce beau ministère dans nos communautés chrétiennes.
* Enfin, il peut y avoir l’intervention de la
communauté elle-même ou de ses dirigeants quand on n’est pas arrivé à trouver,
seul ou en petit groupe, une issue évangélique à un conflit qui risque
d’empoisonner gravement l’atmosphère de la communauté.
Tout cela peut sembler de la petite morale, un
peu étroite, un peu mesquine. Et c’est là que l’apôtre Paul, qui avait fondé et
dirigeait à distance des communautés avec beaucoup de problèmes, nous arrive
avec le mot de la fin : « Ne gardez aucune dette envers personne,
sauf la dette de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a parfaitement
accompli la Loi. » Car l’enjeu de tout cela, c’est finalement l’amour,
donc l’essentiel du message de Jésus. Et par conséquent l’essentiel du
témoignage des chrétiens dans le monde.
Se savoir aimé de Dieu pour mieux nous aimer
les uns les autres : voilà le secret de notre existence comme
chrétiens ; voilà ce qui peut donner envie à d’autres de devenir aussi des
chrétiens, grâce à des communautés qui rayonnent du bonheur d’aimer. Pas sans
problèmes ou difficultés, mais en cherchant encore dans l’amour, jusqu’au
pardon, les solutions qui permettent de témoigner pour l’évangile de manière
crédible, dans une société qui nous observe sans pitié.
Que voilà une belle feuille de route pour nos
vies personnelles, familiales, dans les quartiers ou dans la profession, et
bien sûr dans nos communautés chrétiennes qui, plus que les autres, doivent sans
cesse relever le défi de l’amour selon cette parole de l’apôtre Jean :
« Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des
discours, mais par des actes et en vérité. »
I Jn 3,17
Claude
Ducarroz