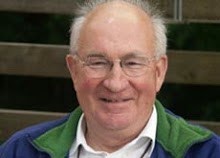Unité 2015
Le monde brûle et les Eglises chrétiennes sont
encore en train de se chicaner pour savoir quelle est la plus chrétienne. Il
est vrai que le mauvais exemple vient de haut : les apôtres, devant Jésus
qui les tança, se disputèrent pour savoir qui était le plus grand parmi
eux ! Cf. Luc 22, 34.
Aujourd’hui nous commençons, comme chaque
année, la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Que nous soyons encore
divisés, c’est un effet malheureux de nos héritages marqués par des
concurrences, des luttes et même des guerres. On n’est pas toujours fier de
notre histoire et de nos histoires.
Qu’il faille maintenant se rapprocher, jusqu’à
la réconciliation, jusqu’à l’unité dans une légitime diversité : c’est un
impératif que nous ne pouvons ni ne devons passer sous silence.
* Un impératif qui nous vient de Jésus lui-même,
notre référence commune puisque, la veille de sa passion, il a prié le Père
ainsi : « Que tous soient un afin que le monde croie… Qu’ils
soient parfaitement un afin que le monde sache que tu m’as envoyé et que tu les
as aimés comme tu m’as aimé. »
* Et un impératif qui vient de notre monde,
tellement labouré par les divisions, les injustices et les violences. Ce monde
dans lequel les chrétiens et les Eglises doivent donner le témoignage que la convivialité
est possible, dans le respect des différences et le partage de valeurs
universelles.
Dès lors ce qu’on appelle l’œcuménisme n’est
pas une branche à option pour quelques spécialistes marginaux, mais une
dimension essentielle de la vie de nos Eglises et par conséquent un ardent
devoir pour chacun de nous.
Mais finalement, c’est quoi, cet
œcuménisme ?
Le pape Jean-Paul II en a donné une définition
simple, mais très pertinente : c’est un échange de cadeaux.
Par nos méchantes divisions, dont nous sommes
tous responsables, chaque Eglise est partie en emportant une portion de
l’héritage chrétien, en se cramponnant à ce morceau, jusqu’à exagérer son
importance ou à défigurer sa présentation. Par exemple les catholiques avec la
papauté ou le culte marial, et les protestants avec le rôle de la Bible et la
liberté d’interprétation personnelle.
Ce faisant, nous avons privé les autres d’un
trésor qui, en soi, devrait être partagé par tous, une fois passé dans le bain
de la conversion qu’on peut aussi bien appeler une réforme.
Il est grand temps maintenant de se rapprocher
les uns des autres par notre foi commune au Christ et par des gestes de
fraternité afin de remettre ensemble, sur la table de famille, les pièces
précieuses d’un puzzle évangélique que nous avions dispersés aux quatre vents
par nos infidélités et nos sectarismes.
C’est un travail long et difficile, qui nous
remet tous en question. Il concerne nos modes de pensée, mais aussi nos
traditions liturgiques et nos références morales. Il y va d’un discernement
communautaire pour faire la distinction entre ce qui est exigé par le devoir
intangible d’unité dans la foi et ce qui est acceptable au nom de légitimes
diversités dans la manière d’exprimer cette foi et de la vivre en communautés
sœurs mais pas semblables en tout.
Il y a entre nous encore des divergences
séparatrices qu’il nous faut soumettre au feu de l’Esprit de l’évangile dans
l’humilité et la prière. Il y a aussi –et il s’agit de le reconnaître et même
de s’en réjouir- des différences qui sont des richesses dans la variété
symphonique d’Eglises en voie de retrouvailles après des siècles d’ignorance, d’affrontements
et de bouderies jalouses.
Des autorités d’Eglises oeuvrent sur ce
chantier, comme on l’a vu récemment entre le pape François et le patriarche
orthodoxe Bartholomée. Des théologiens y travaillent aussi, par exemple dans un
cercle d’experts catholiques et
protestants intitulé le Groupe des Dombes. Il y a aussi toutes ces prières pour
l’unité qui montent vers le ciel, en particulier durant cette prochaine
semaine, sans oublier des communautés comme celle de Taizé ou de Grandchamp qui
s’engagent de manière prophétique, notamment parmi les jeunes, pour la pleine
réconciliation des Eglises et des chrétiens.
Et nous, qu’est-ce que nous faisons ? Il
serait faux de croire que tout est déjà résolu entre nous puisque nous ne nous
faisons plus la guerre. Mieux : nous prions ensemble, nous nous entendons
bien, nous oeuvrons de concert pour un monde meilleur, notamment au service des
pauvres, des souffrants et des exclus.
Il faut admettre, sans se laisser décourager,
qu’il y a encore des nœuds à dénouer dans les doctrines. Mais rien n’empêche
que nous, les chrétiens de la base, nous donnions le témoignage de frères et
sœurs toujours plus unis quand il s’agit de proclamer notre foi en Jésus le
Christ, de dire au monde l’espérance issue de l’évangile pascal et surtout de
nous aimer sans attendre d’être pleinement réconciliés.
Tous, à commencer par nos Eglises comme telles,
nous avons assez de pauvretés pour avoir besoin de recevoir avec reconnaissance
des autres, assez de richesses pour avoir la joie de les partager humblement
avec les autres et assez d’impulsions spirituelles pour nous retrouver ensemble
sur le terrain de la mission et du témoignage dans notre société.
Chrétiens et Eglises, nous avons assez souffert
et fait souffrir par nos divisions. Il s’agit maintenant de procéder par
additions de nos trésors purifiés dans l’essoreuse de l’évangile pour les
offrir ensemble au monde. Oui, des trésors plus riches dans leurs variétés,
plus transparents dans leur beauté, plus chaleureux dans leur rayonnement.
Que chacun puisse dire à l’autre, à commencer
par l’autre chrétien près de lui : Tu me manques, mon frère, ma sœur. J’ai
un cadeau pour toi. Je me réjouis de découvrir et de recevoir le tien. Et nous
rendrons grâces ensemble à l’auteur de tous les cadeaux : Jésus notre
commun Seigneur et frère, « afin que le monde sache que tu les as aimés
comme tu nous as aimés ».
Claude Ducarroz