Claude Ducarroz
L’avenir du christianisme
Sur le vif…
Le christianisme dans son
acception la plus large, je l’ai rencontré hier soir lors d’une préparation au
baptême.
Il y avait là d’abord des
couples engagés comme témoins. Plusieurs font partie d’Eglises différentes,
ceux qu’on appelle des « couples mixtes », en l’occurence composés
d’un catholique et d’un protestant.
L’une des mamans était
franchement catholique et même pratiquante avouée. Il y avait un parrain de
confession protestante dont la foi était fort vague et le Dieu décrit avec des
majuscules : une Force, une Energie, un Amour, une Vie. Il y avait aussi
des catholiques qui s’affirmaient tels, mais qui aussitôt ajoutaient prudemment
« Nous sommes non-pratiquants ». Il y avait encore un monsieur très
éclectique qui broute à tous les râteliers de la spiritualité, très au fait
d’ailleurs des diverses religions. Il y avait aussi une maman venue du
tiers-monde, qui avait été baptisée à l’âge de 28 ans. Elle a dit regretter de
n’avoir pu l’être plus tôt et elle ajouta la raison : « Notre famille
était trop pauvre pour organiser une fête de baptême ». Et enfin, il y
avait deux parents divorcés qui présentaient leur enfant, des divorcés non
encore remariés.
Voilà la palette des chrétiens
plus ou moins chrétiens, de différentes confessions, la palette de
christianisme que j’ai rencontrée hier soir.
Le christianisme des Eglises
Le christianisme ! Quel
est ce christianisme dont nous parlons ? Est-ce l’Eglise sous la forme des
Eglises et des communautés ecclésiales ? Un christianisme bien étiqueté et
bien affirmé. Certes, il existe.
Je pense à ces communautés de
croyants qui professent la foi apostolique et la redisent chaque dimanche avec
plus ou moins de conviction. Je songe à ces communautés avides des sacrements
célébrés dans les différentes liturgies. Je pense à ces rassemblements de
prière, plus ou moins bien fréquentés mais tous placés sous le label chrétien
de telle ou telle Eglise. Ils sont des croyants qui mènent des actions bien
brevetées comme chrétiennes.
Voilà un type de christianisme
qui, chez nous, avait jadis beaucoup de visibilité et d’influence. Il faut le
reconnaître : maintenant ce christianisme-là est en forte diminution. La
« pratique religieuse », appelée traditionnellement ainsi, est en
baisse très inquiétante. Nous retournons peu à peu à la dimension du levain,
minuscule dans une grande pâte humaine. C’est le « petit troupeau »
dont parlait Jésus dans l’Evangile (Cf. Lc 12,32), un christianisme qui se
rapetisse quant à la quantité, quant au nombre recensé.
Mais dans ce christianisme-là,
il faut reconnaître qu’il y a des apports libres très impressionnants. Je pense
encore à ces couples animateurs dans la préparation aux divers sacrements. Un
peu partout se lèvent des chrétiens qui, sur appel ou spontanément, s’engagent
dans les communautés, prennent en charge leur avenir en toute responsabilité
baptismale. On le voit en particulier lorsqu’il y a des crises dans telle ou
telle communauté. Ces communautés continuent de vivre et parfois encore plus
intensément qu’avant.
Les gens de ces communautés
chrétiennes ont des exigences très élevées en spiritualité, en prières, en
nourriture évangélique, que ce soit par la Parole ou par les sacrements. Ce
sont des chrétiens qui s’affichent et travaillent, mais aussi demandent autant
qu’ils donnent. Chez les catholiques, il faut le reconnaître, ce sont surtout
des laïcs depuis le Concile Vatican II. Les services assumés par les laïcs dans
nos communautés sont vraiment impressionnants. Il me semble que cette montée en
force des laïcs chez nous est une chance dans la mesure où elle intègre la
dimension œcuménique parce que l’apostolat des baptisés, c’est l’apostolat de
tous les chrétiens.
Un phénomène nouveau est apparu, qui cherche
encore sa voie et, par conséquent, doit être encore vérifié. C’est l’émergence
des « nouvelles communautés », ainsi nommées parce qu’elles
proviennent de milieux charismatiques très étiquetés, avec des fondateurs -
d’ailleurs souvent laïcs- qui exercent un ministère de direction et de
discernement. Il faut le reconnaître : ces nouvelles communautés sont
particulièrement vivantes, qu’elles soient tournées vers la spiritualité, vers
la formation ou vers l’engagement dans le monde au nom de l’Evangile. Mais je
dois dire qu’elles ont encore besoin de mûrir, de se confronter au réel, de
manifester leur persévérance dans la durée. Il ne faut pas éteindre l’esprit de
prophétie mais, comme dit l’apôtre, discerner ce qui est bon et le retenir (Cf.
I Th 5,19-21). Nous sommes à l’heure des bourgeonnements, des premières fleurs,
peut-être même des premiers fruits. Mais pour savoir quel avenir ont ces
communautés et quel futur elles offrent à l’Eglise, je crois qu’il faut encore
attendre un peu.
La christianité
Le christianisme, c’est aussi
autre chose de plus large. J’appellerai cela d’un vocable nouveau : la
christianité.
La christianité, pour moi, ce sont d’abord les
« ex » des communautés, à savoir des gens qui ont grandi dans des
communautés chrétiennes, qui ont souvent reçu en elles une formation, une
catéchèse, parfois ont même exercé des responsabilités en leur sein. Mais,
aujourd’hui, ils s’en sont détachés, ils s’en sont éloignés. La christianité,
je la trouve parmi ces chrétiens critiques, déçus, que j’ai appelés ailleurs « cabossés ».
Ils se sentent en malaise d’Eglise parce qu’ils ont été plus ou moins exclus ou
se sont sentis exclus à un moment donné. Cela fait quand même un gros tas de
croyants qui se disent non-pratiquants, mais qui ont beaucoup reçu des Eglises
jadis, qui s’y réfèrent encore par tradition. Ils en vivent les valeurs de
base. Ils ont peut-être gardé de leur pratique religieuse une religiosité, des
réflexes de piété. Beaucoup prient encore. Oui, on les entend nous dire
« Je ne vais pas à l’église, mais je prie chez moi » ou alors
« Je vais à l’église justement quand il n’y a personne ». Il y a là
tout un peuple très nombreux qui est encore dans le rayonnement des Eglises,
mais qui se trouve marginal par rapport à leurs structures et à l’écart de
leurs rassemblements.
Ces hommes et ces femmes ont
une certaine morale puisée dans les vertus reçues en Eglise, une certaine
manière de se comporter avec honnêteté, avec justice, en mettant l’accent sur
l’amour. Ce sont des chrétiens issus des communautés, mais sans communauté
actuelle.
Certains sont des
occasionnels ; ils nous confient leurs enfants pour la catéchèse et les
sacrements. Ils veulent bien transmettre encore quelque chose de l’héritage
chrétien, de la tradition qui les a marqués, mais ils ne veulent pas être
inféodés à un système obsolète à leurs yeux. Ils sont nombreux, même si
évidemment leur nombre baisse aussi dans la mesure où la première catégorie
diminue.
Ce qu’ils attendent de l’Eglise
de leurs souvenirs et de leur enfance, c’est un certain accueil, car ils en ont
encore besoin. Une sympathie au moins sporadique et surtout une absence de
jugement. Ils sont des chrétiens du seuil, du parvis. Ils sont comme sortis de
la nef de l’église mais ils regardent encore de temps en temps à l’intérieur ou
viennent subrepticement participer à telle ou telle célébration occasionnelle.
Ils sont les chrétiens de la première zone périphérique.
Le christianisme dans la cité
Troisièmement, j’appellerai
encore « christianisme » la fécondité de l’Evangile et du témoignage
des chrétiens dans le monde, ce qu’il reste de cette contagion évangélique dans
la société au-delà même de ceux qui se rattachent au christianisme ou se
souviennent des Eglises. Le christianisme comme vitalité existe au-delà même
des Eglises et des chrétiens eux-mêmes. C’est un certain rayonnement qui
éclaire la route d’une société, qui indique des valeurs à une civilisation, qui
transfigure les réalités humaines les plus quotidiennes en leur donnant un
sens, en les illuminant discrètement du dedans, en les corrigeant parfois. Ce
christianisme sécrète un certain type de critères et de comportements.
Bien sûr, il y a dans ce christianisme diffus,
qui a peu à peu investi la société, beaucoup d’ambiguïtés.
Les droits de l’homme, par
exemple. Il est prouvé, n’est-ce pas ? que ces droits ont pu émerger et
s’imposer dans un terreau imprégné de christianisme à partir d’une certaine
définition de la personne comme être « sacré » et pôle incontournable
de la société. Mais nous savons aussi que, d’une part ces droits se sont
parfois imposés contre l’avis de l’Eglise et contre une certaine militance des
chrétiens antidémocratiques et, d’autre part, nous constatons que dans l’Eglise
elle-même ces droits ne sont pas toujours reconnus et vivants. Et surtout nous
voyons qu’il y a toujours de nouveaux esclavages à l’horizon, de nouvelles
dictatures, de nouvelles guerres. Il reste que les droits de l’homme sont un
des enfants naturels du christianisme même si les Eglises ont eu de la peine à
les reconnaître.
Il y a aussi dans les domaines
de l’écologie et de la médecine toutes sortes de progrès qui, je le crois, sont
dus en partie au rayonnement de l’Evangile. Finalement l’homme debout, l’homme
qui se tient bien dans son environnement, cette relation de l’homme avec l’univers
ressort de la Bible où la création est comme un jardin pour ce grand jardinier
libre et responsable qu’est l’être humain. Tout cela se traduit maintenant par
cette montée des valeurs écologiques.
On peut parler aussi de la
médecine. La thérapeutique audacieuse ne vient-elle pas de l'Evangile, quand le
Christ Verbe incarné assume lui-même un corps, guérit des corps ainsi que des
esprits et promeut finalement la dimension physique de l’homme à l’intérieur
même de la Résurrection ? Le regard
positif sur le monde et sur l’homme créés bons
guide, je crois, même inconsciemment, les progrès des sciences et des
techniques pour le bien-être de l’homme. Même si – et là il faut toujours
émettre quelques bémols – on peut accuser l’Eglise ou les Eglises d’avoir injustement
traité par exemple la sexualité et d’avoir peut-être freiné certains progrès
dans le domaine des recherches psychologiques et psychiatriques. Restons
humbles !
Mais aujourd’hui, à l’heure où,
dans ces secteurs d’activité, il y a aussi beaucoup d’apprentis sorciers,
est-ce qu’il n’est pas nécessaire de retrouver des repères, de mettre en
évidence des priorités ? Dans cette recherche d’une bio- éthique, d’une
éthique de la vie, les valeurs de l’Evangile n’ont-elles pas encore toute leur
chance ?
Parlons encore de la sexualité
et de la liberté.
Nous voyons aujourd’hui dans
notre monde une revendication extraordinaire de liberté, privée et publique,
par rapport à la sexualité dans toutes ses manifestations possibles. En même
temps, nous sentons monter des exigences fortes. Voyez par exemple la
pédophilie, le viol, le harcèlement sexuel. Ils sont aujourd’hui mis au pilori
davantage que jadis. Il y a donc d’un côté des dérives graves dans le domaine
de l’usage de la sexualité, mais aussi des progrès.
La famille reprend de la vigueur comme lieu
d’épanouissement des personnes, comme condition de leur l’enracinement dans une
société et une tradition, comme espace du partage et de l’éducation à la
liberté. Là aussi, je crois qu’il y a tout un rayonnement du christianisme qui
s’investit sans étiquettes dans ces tâtonnements autour de la sexualité et de
la famille.
Enfin parlons de la justice.
Les exigences de la justice
pour tous sont une des caractéristiques de notre société. Nous sommes encore très loin du compte.
Justice par rapport au tiers-monde, justice par rapport à la pauvreté dans nos
sociétés d’abondance. C’est vrai, là aussi, que l’Eglise ne s’est pas toujours
située aux côtés de celles et ceux qui luttaient pour la justice, tant elle eut
peur elle-même de la lutte des classes. C’est vrai qu’elle est restée trop
longtemps sourde et aveugle devant les injustices dans la société industrielle
et le monde ouvrier. N’empêche que les valeurs de justice de l’Evangile, ce
« communautarisme » qui nous vient du Christ et de la première
Eglise, ont aussi motivé beaucoup d’engagements parmi les chrétiens et parmi
d’autres. Ils ont peu à peu changé notre humanité. Ils continuent de faire
réfléchir sur une société qui soit enfin juste et équitable. Aujourd’hui, il y a
un grand défi pour l’économie. Est-ce que la nouvelle économie globalisée,
mondialisée est un chemin de justice, ou est-elle une glissade vers une
nouvelle exploitation, un nouveau partage du monde entre des tout riches et des
tout pauvres ? Là aussi le prophétisme de l’Evangile peut et doit encore
s’exercer.
L’espérance qui ne peut décevoir
Pour terminer, je voudrais dire
combien l’espérance du christianisme doit être placée d’abord en Dieu.
Finalement, c’est Dieu qui tient le monde et l’histoire dans ses mains. Sans
doute, il nous confie l’un et l’autre, mais nous restons tous suspendus à sa
volonté créatrice et rédemptrice. En tout homme veille l’Esprit. En lui habite
la nostalgie de l’homme nouveau qui fut au début, peut-être, et qui sera
certainement à la fin. Il y a dans l’homme comme une connivence avec le Christ,
l’homme réussi anticipé dans l’histoire, qui nous attend au terme de cette
immense aventure.
Alors les Eglises sont là pour
se laisser d’abord interpeller elles-mêmes à partir de cet Evangile qui nous
remet en question, nous les premiers les chrétiens. Ces Eglises sont aussi là
pour proclamer dans la société les voies de la véritable humanisation.
Clairement et humblement.
Qu’est-ce que le progrès ?
qu’est-ce qu’une humanité réussie ? qu’est-ce qu’un homme humain, vraiment
humain ? En dénonçant les dangers, en signalant les fausses pistes,
l’Eglise et les Eglises rendent service à l’humanité. Encore faut-il que,
positivement et d’abord à l’intérieur même des communautés chrétiennes, nous donnions
le témoignage d’une humanité animée par le partage, la justice, le respect et
la liberté. Que les Eglises soient comme des mini-sociétés, des microcosmes
évangéliques dans lesquels les hommes pourront reconnaître, au-delà même des
paroles, le début du monde nouveau qui nous est promis à tous.
Oui, comme nous avons besoin de
prophètes dans nos communautés, dans les Eglises ! De prophètes incarnés
dans les cultures, dans les civilisations, dans la politique, dans l’économie,
dans la science avec tous les nouveaux défis qu’elle doit affronter, dans la
vie sociale, dans l’éducation. Partout, nous pouvons, je crois, allumer des
signes d’espérance, indiquer des chemins et peut-être entraîner avec nous tant
d’hommes et de femmes sincères qui, sans se référer à l’Eglise et parfois même
un peu en colère contre elle, cherchent tout comme nous un nouveau style
d’humanité dans un nouveau type de société. En ce sens-là, si nous plaçons
notre espoir en Dieu, si nous reconnaissons aussi le travail de l’Esprit en tout
homme de bonne volonté, si nous commençons par nous laisser nous-mêmes
transfigurer, transformer par l’Evangile, je crois que nous pouvons être
optimistes pour l’avenir du christianisme dans cette société.
Il y a encore de nombreux
chrétiens, il y a aussi des recommançants, il y a des « chrétiens »
qui s’ignorent. Dans la solidarité humaine la plus large, tous peuvent donner à
notre monde l’exemple d’un Evangile qualitativement significatif. Chacun à sa
manière renvoie comme en un miroir quelque chose du visage du Christ, quelque
chose du visage de Dieu.
Claude Ducarroz
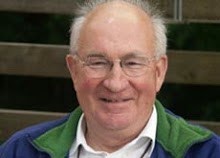
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire